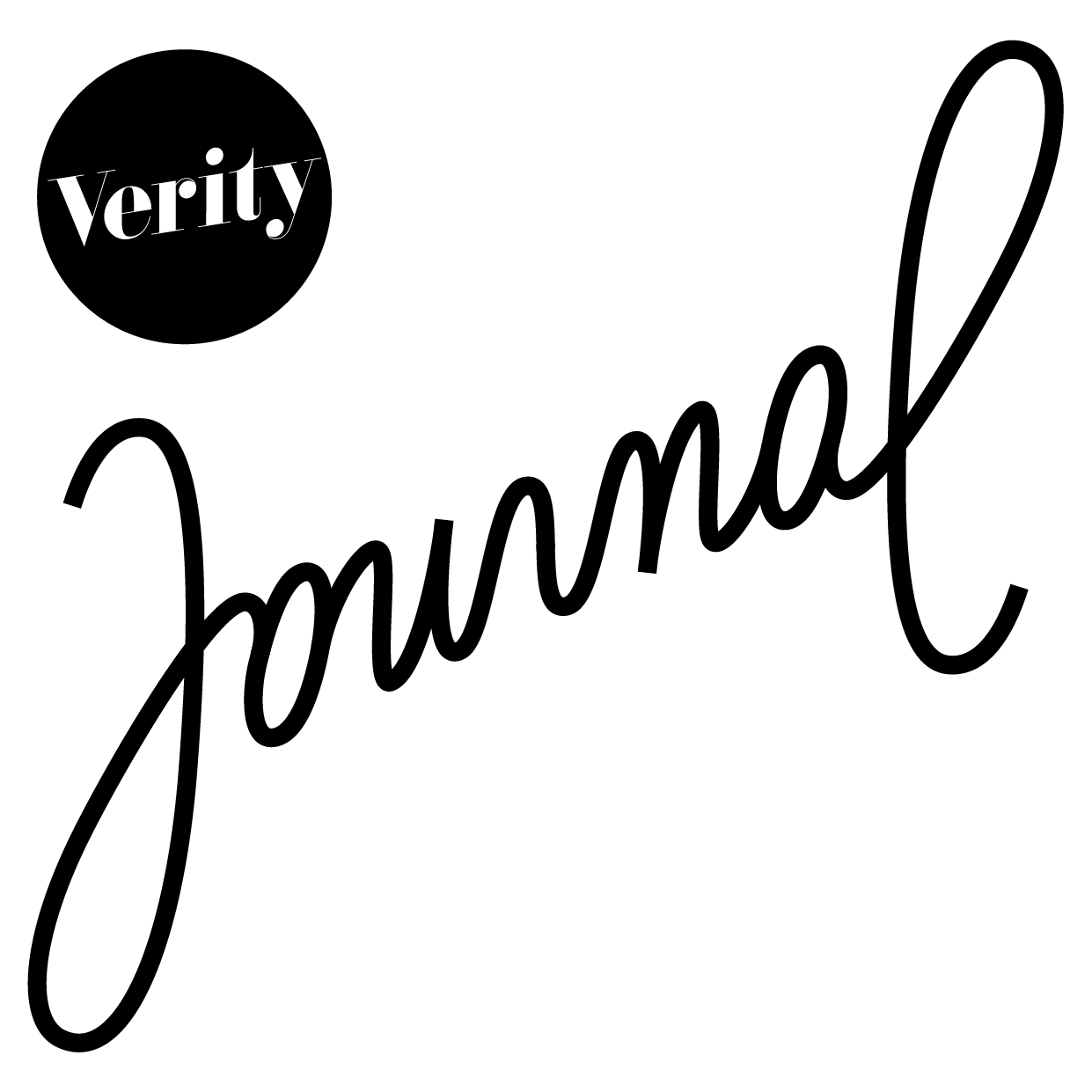L’enfer c’est les Français : Une lettre depuis Montréal
Cher Verity, J’ai été une femme dans tout un tas de pays. J’ai été une femme en Turquie, j’ai été une femme en Russie, au Maroc, au Royaume-Uni, ou en Italie. J’ai été une femme en France surtout, la plus grande partie de ma vie.
Ecrit par Camille Teste
Illustration de Sarah Ulrici

Déjeuner sur l’herbe
Partout, j’ai eu tout un tas de copains. Des garçons, avec des vêtements de garçons, de têtes de garçons et des blagues de garçons. J’ai eu des amoureux, des confidents, des plans cul, des camarades, des potes de passage, et des amis qui restent.
En revanche, s’il y a bien une espèce que j’ai toujours eu du mal à garder c’est une bande de copines et, a fortiori, d’amies hétérosexuelles. Longtemps, j’ai pensé que le problème venait de moi en tant que personne. De caractère plutôt alpha, j’ai toujours été un peu séductrice, totalement no-fucks-given et pas forcément bien dans ma peau pour autant.
Pourtant, ces dernières années, je me suis apaisée, et suis devenue plus girl-friendly. Moins excentrique dans mes mots, plus modestement habillée, moins adepte du sourire qui désarme. Mais contrairement à ce que je pensais, mes relations avec les autres femmes n’ont pas changé pour autant. Combien de filles m’ont poussées en boite de nuit ? Combien de nanas m’ont coupée la route en voiture ? Combien de serveuses ont dragué mon copain sous mes yeux ? Combien de collègues féminines m’ont détestée par principe ?
Et puis, il y a quelques mois, j’ai emménagé à Montréal. Et j’ai eu beau traîner dans des bars, multiplier les rendez-vous professionnels avec des working girls de toutes sortes, côtoyer des femmes dans les salles de yoga, les salons de coiffure, les boutiques de fringues, les ascenseurs ou les magasins exigus, je n’ai eu le droit qu’à des sourires, des remarques bienveillantes ou à une indifférence sincère et somme toute légitime.
J’ai vu tellement de jolies filles inconnues l’une pour l’autre se jeter des sourires, j’ai entendu tellement de gentils mots échangés dans des toilettes de restaurants, j’ai reçu tellement de compliments de femmes en couple, en présence de leur moitié, que j’en suis arrivée à remettre en cause la croyance qui avait façonnée une bonne partie de ma vie de femme, à savoir qu’il n’y avait pas pire ennemie, pour une femme, qu’une autre femme.
Forte de cette frappante découverte, je me suis interrogée sur les raisons d’une telle différence de comportement. En observant les femmes autour de moi, j’ai commencé à déceler d’autres différences. J’ai vu des poils, beaucoup de poils. Sur les jambes, sous les bras. Des poils que je n’avais vus, jusqu’à maintenant, que sur les corps des néo-hippies de mon université. J’ai vu du gras aussi. Pas du gras dissimulé dans des tenues « pour femmes rondes », mais laissé à l’air libre, mini short et crop top à l’appui. Et puis j’ai vu des voiles, portés de différentes manières, des cheveux rasés, des femmes trans, des perruques en tout genre…
En fait, j’ai surtout vu des femmes qui n’avaient pas l’air de porter au quotidien ce que beaucoup de Françaises s’imposent : la nécessité, peut-être, de correspondre à cette « parisienne » chic, mince, discrète et intemporelle. Cette parisienne qui, dans le fond, n’impressionne plus que les rédactrices en chef de quelques magazines régime-mode-horoscope, qui jugent depuis bien trop longtemps la femme sur l’échelle Inès-de-la-Fressange.
J’ai fait part de ce constat à mon homme : les femmes ne seraient donc pas ces ennemies intimes sur lesquelles, depuis fort longtemps, et sauf exception, j’avais fait une croix. Il se trouve que mon homme vient d’un pays qui a longtemps été colonisé. « Il faut croire que les Montréalaises ne souffrent plus du complexe du colonisé », m’a-t-il répondu sans plus de précaution.
On parle du complexe du colonisé lorsqu’un membre d’une minorité opprimée a plus intérêt à se plier aux normes de la communauté dominante, plutôt qu’à faire preuve de solidarité envers un autre membre de sa minorité. C’est un policier d’origine maghrébine qui va lui-même pratiquer le contrôle au faciès envers des personnes arabes ; c’est un portier haïtien noir qui va faire subir un véritable interrogatoire à un couple congolais avant de les laisser entrer dans l’immeuble dont il a la charge. Ce sont, en somme, des préjugés nés dans la communauté dominante qui sont intériorisés, souvent inconsciemment, par certains membres de telle ou telle minorité.
Alors, en France, les femmes en seraient-elles encore à jouer le jeu du mâle dominant ? Auraient-elles encore plus à gagner à voir a priori les autres femmes comme des rivales-hystériques-incapables plutôt que comme des alliées, ou simplement des êtres neutres ? Si tel est le cas, la situation des femmes est-elle si différente en France et au Canada ? Difficile de répondre à cette question, les leviers qui tendent à dominer les femmes étant subtiles et pernicieux. Bien sûr, le Québec n’est pas un modèle de vertu absolue.
Le salaire des femmes est toujours inférieur à celui des hommes, les femmes sont les plus touchées, et de loin, par les agressions sexuelles et les violences conjugales, et leur présence dans les sphères décisionnelles est bien inférieure à celle de leurs homologues masculins. Bref, rien de nouveau sous le soleil, même si les choses évoluent lentement.
D’un point de vue individuel cependant, j’observe que mes choix quotidiens ont évolué depuis mon arrivée en terres québécoises : est-ce que je peux passer en jupe devant un groupe de plusieurs hommes sans me sentir déshabillée ? Oui. Est-ce que je peux faire du yoga dans les parcs, écarter les jambes, y faire le grand écart, sans me sentir sexualisée ? Oui. Est-ce que je peux faire du vélo en short parce qu’il fait 35°C sans avoir l’impression d’effectuer un acte militant ? Absolument. Je n’aurais jamais fait de tels choix dans ma vie parisienne. Ou alors seulement les jours où j’étais sûre de passer ma journée entourée d’hommes, ou bien parce que j’étais d’humeur à « provoquer » : comme si porter un vêtement court relevait d’une quelconque pugnacité.
Le temps autrefois accordé à s’interroger sur le caractère provocant ou non de telle ou telle tenue, ou sur le bien-fondé de passer par telle ou telle rue, est alloué à autre chose. Débarrassée des regards et des remarques parasites qui constituent le harcèlement de rue, j’ai l’impression de pouvoir me concentrer sur autre chose. Me faire des copines par exemple.
– Extrait du n°2 de Verity Magazine
Envoyer-nous vos poèmes, lettres et contributions